
Congé parental pour le 3ème bébé : droits, démarches et conseils

La “descente d’organe”, également connue sous le nom de prolapsus, est une pathologie fréquente – et généralement bénigne lorsqu’elle est prise en charge à temps – qui touche entre 30 et 50% des femmes de tous les groupes d’âge, sans être forcément symptomatique. Les risques de développer cette pathologie augmentent avec l’âge, des facteurs favorisants comme le port régulier de charges lourdes, le surpoids ou… la grossesse. C’est sur ce dernier point que nous allons nous concentrer.
Descente d’organe après l’accouchement : faisons le point.
La descente d’organe, ou prolapsus, survient lorsque les structures de soutien des organes pelviens sont affaiblies, après une grossesse par exemple. Voici ce qu’il se passe concrètement.
Les organes pelviens – tels que l’utérus, la vessie ou le rectum – sont soutenus par un réseau complexe de muscles, de ligaments et de tissus. Ces structures forment une sorte de hamac qui maintient les organes en place au-dessus du vagin.
Lorsque ces muscles et ligaments se relâchent trop, comme après une grossesse ou un accouchement, ils peuvent avoir du mal à soutenir les organes pelviens correctement.
Une descente d’organe se manifeste par le glissement anormal d’un ou plusieurs organes pelviens vers le bas, parfois jusqu’à s’extérioriser au-delà de la vulve. On catégorise généralement trois types de prolapsus :

Les symptômes du prolapsus en post-partum peuvent varier en intensité d’une femme à l’autre et incluent :
Pour diagnostiquer une descente d’organe après l’accouchement, un examen clinique est généralement suffisant, couplé à un interrogatoire. Votre médecin ou sage-femme effectuera un toucher vaginal pour évaluer la position des organes pelviens. Pendant cet examen, on peut aussi vous demander de tousser ou de pousser légèrement pour mieux estimer la gravité du prolapsus. Cet examen permet également de déterminer le type de prolapsus (cystocèle, rectocèle, hystérocèle).
Si vous avez des questions sur le sujet, n’hésitez pas à télécharger l’application May. Une équipe de sages-femmes vous répond 7j/7 de 8h à 22h.
 Descente d’organe : facteurs de risque et causes
Descente d’organe : facteurs de risque et causesUne descente d’organe après un accouchement peut être influencée par plusieurs facteurs.
L’un des principaux facteurs de risque est le relâchement des muscles et ligaments du périnée et des muscles du plancher pelvien, parfois causé par l’accouchement. En effet, le passage du bébé à travers le vagin peut étirer et affaiblir ces muscles, compromettant leur capacité à soutenir correctement les organes pelviens. Ce processus peut être aggravé par :
D’autres facteurs, qui ne sont pas directement liés à l’accouchement, peuvent également jouer un rôle dès la grossesse. Par exemple, une constipation chronique peut entraîner une pression accrue sur le plancher pelvien, tout comme le port de charges lourdes ou une toux chronique. De plus, des facteurs comme l’obésité et la sédentarité peuvent affaiblir les muscles et ligaments pelviens au fil du temps.

Bien qu’un prolapsus ne soit généralement pas dangereux, il peut affecter votre qualité de vie (perturbation de votre vie sociale, professionnelle, affective, sportive…). Heureusement, des solutions existent.
Pour les cas de prolapsus légers à modérés, les traitements non invasifs sont souvent recommandés en premier. La rééducation périnéale – souvent réalisée avec l’aide de votre sage-femme, est une approche non invasive qui peut être extrêmement bénéfique pour corriger une descente d’organe après l’accouchement. Elle se compose d’une série d’exercices conçus pour renforcer les muscles du périnée et les muscles du plancher pelvien, aidant ainsi à soutenir les organes pelviens et réduire les symptômes. Ces exercices, qu’on appelle aussi exercices de Kegel, peuvent également être réalisés avec l’aide d’un·e kinésithérapeute spécialisé·e.
En complément, l’utilisation de dispositifs comme les pessaires (des anneaux flexibles en silicone médical, insérés dans le vagin afin d’aider à maintenir les organes pelviens en place) peut offrir un soutien supplémentaire en réduisant la sensation de relâchement et les fuites urinaires.
Pour les cas plus sévères, où les ces traitements ne suffisent pas, une intervention chirurgicale peut être envisagée. Les options chirurgicales varient en fonction du type et de la gravité du prolapsus. Elles peuvent inclure des procédures pour repositionner et soutenir les organes pelviens en utilisant des tissus propres ou des matériaux synthétiques.
A savoir : la prise en charge d’un prolapsus n’est pas une urgence et son aggravation potentielle est lente dans le temps.

C’est généralement la rééducation périnéale qui vous est conseillée afin de limiter les risques de faire une descente d’organe après l’accouchement. Cette rééducation commence généralement 6 à 8 semaines après l’accouchement et est prise en charge à 100% par l’Assurance Maladie pendant les 3 ans qui suivent l’accouchement. Comme évoqué plus haut, une rééducation périnéale se fait généralement en compagnie d’un·e sage-femme ou d’un·e kinésithérapeute.
Il vous sera également conseillé d’éviter – autant que possible – de porter des charges lourdes ou encore d’éviter d’exercer une pression trop importante sur votre plancher pelvien (toux, poussée aux toilettes). Une alimentation riche en fibres peut également aider à prévenir la constipation (qui peut également être à l’origine d’un prolapsus dans certains cas).
L’activité physique, et la lutte contre le surpoids et la sédentarité sont aussi des axes à explorer.
Une descente d’organe après l’accouchement est donc un phénomène courant et pas nécessairement grave avec un suivi médical adapté. Une rééducation périnéale peut aider à renforcer votre périnée et votre plancher pelvien, limitant ainsi le risque de développer un prolapsus.

**
Crédits photos : DragonImages | Rawpixel | Image-Source | yosss1 | TDyuvbanova | krisprahl
Il est possible que certains liens ci-dessous ne soient plus actifs. Dans ce cas, n'hésitez pas à vous référer directement aux sites concernés.
Inscrivez-vous
à notre newsletter
pour tout savoir sur votre grossesse
Vous serez ainsi alerté lors de la publication de nouveaux articles.
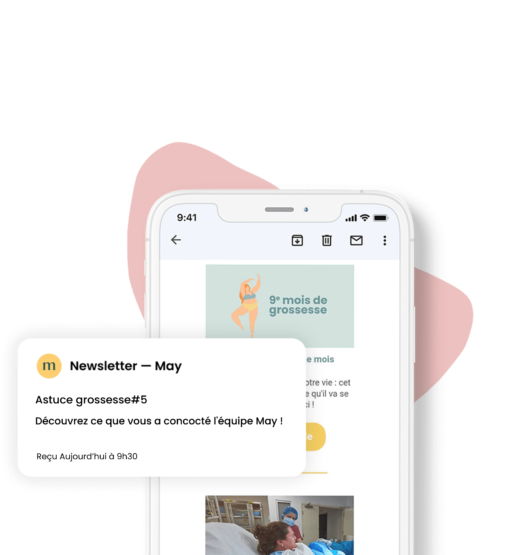
Ces ressources pourraient vous intéresser

Congé parental pour le 3ème bébé : droits, démarches et conseils

